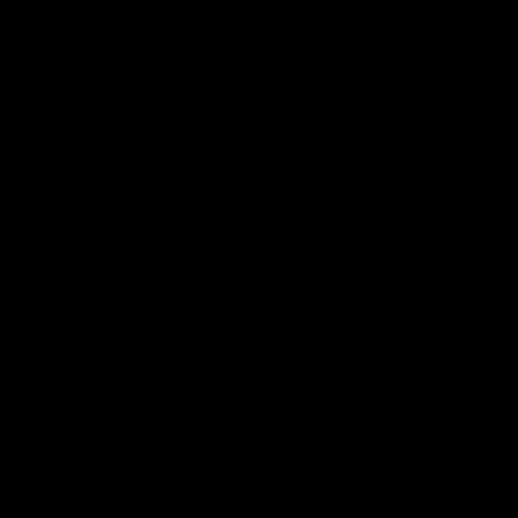Les numéros de maillots de football sont devenus indispensables, aussi bien pour les spectateurs, que pour les joueurs. Ils font partie d’un héritage que l’on croit présent depuis le début de l’histoire du football. Pourtant, ceux-ci ont mis un peu plus de temps avant de faire leur apparition, et ont une histoire bien à eux. Aujourd’hui, ces numéros rappellent un poste et un joueur en particulier, représentent une certaine façon de jouer au football, et font surtout partie intégrante de l’attirail du footballeur.
Un numéro sur un maillot, c’est une histoire, une attirance envers un style de jeu que l’on affectionne, tout simplement une identité. Et cette personnalisation du maillot n’a pas été créée en même temps que le football lui-même. Pour la petite histoire, avant la Coupe du monde 1958, la Fédération brésilienne avait oublié d’attribuer des numéros de maillot à ses joueurs et la FIFA a attribué les numéros un peu au hasard.
C’est Pelé, jeune attaquant remplaçant de la Seleção au début de la Coupe du monde, qui a obtenu le numéro 10. Mais pourquoi parle-t-on aujourd’hui de numéro 10 pour le meneur de jeu d’une équipe ? pourquoi parle-t-on de numéro 9 concernant les avants centres, pourquoi les numéros 2, 3, 4 et 5 pour les défenseurs, les 6 et 8 pour les milieux et les 7 et 11 pour les ailiers d’une équipe. Il y a une explication. WeLoSport vous explique tout !
L’origine des numéros sur les maillots
Il faut remonter à 1928 pour trouver la première trace de numéros sur des maillots de footballeurs. À cette époque, le football est évidemment très populaire en Angleterre où l’on expérimente pour la première fois la numérotation sur les maillots. Le 25 août 1928, les deux rencontres Sheffield Wednesday vs Arsenal et Chelsea vs Swansea Town, permettront pour la première fois de voir des numéros derrière la tunique des joueurs. À l’époque, on faisait alors au plus simple : les numéros allaient de 1 à 11, et chacun d’entre eux définissait un poste bien précis
Un entraîneur révolutionnaire des années 20 et 30, Herbert Chapman, qui était aux commandes d’Arsenal et qui était le créateur de la fameuse tactique du WM va ainsi donner de l’importance à chaque numéro de maillot pour conférer un rôle à chaque joueur de son équipe. Alors, avant la tactique du WM, les équipes de football jouent quasiment tout en 2-3-5, une tactique surnommée la pyramide.
Il y a un gardien qui a le numéro 1, les deux défenseurs qui ont les numéros 2 et 3, les trois milieux de terrain avec le numéro 4, 5 et 6. On avait ensuite 5 attaquants, le numéro 7, 8, 9, 10 et 11. On les dénombre de droite à gauche. De cette manière, l’ailier droit a le numéro 7, les 3 attaquants axiaux ont les 8, 9 et 10, l’ailier gauche, le 11. Ce n’est pas une tactique d’une équipe de Guardiola, mais bien le dispositif des équipes avant les années 30.
Le passage du 2-3-5 au 3-2-3 est simple. On va faire reculer un milieu de terrain en défense centrale. Donc le numéro 5 va s’insérer entre les numéros 2 et 3. Il reste donc deux milieux de terrain et surtout, l’entraîneur va faire reculer deux des trois attaquants axiaux. On a la création des milieux offensifs avec le numéro 8 et 10 qui sont un peu plus libre derrière l’avant-centre qui garde donc le numéro 9.
Le passage à 4 défenseurs
En Europe et en Amérique du Sud, on va rapidement passer à quatre défenseurs. Les défenseurs à droite et à gauche ont conservé les numéros 2 et 3. Et en charnière centrale dans l’axe, le numéro 5 va être accompagné par le numéro 4 ou par le numéro 6. Il n’y avait pas vraiment de normes à cette époque-là. En Angleterre, on va avoir les numéros 5 et 6 en défense centrale avec le numéro 4 en tant que milieu devant la défense centrale.
En Amérique du Sud, c’est le numéro 5 qui va être le joueur placé devant la défense et qui va mener la relance. Ça va devenir un poste super important. Mais au fil du temps, c’est évidemment le numéro 6 que l’on va attribuer au milieu défensif de l’équipe et le deuxième le milieu de terrain, le milieu de terrain relayeur, aura le numéro 8.
Devant, dans le 4-2-4 ou le 4-4-2, les joueurs sur les côtés restent les numéros 7 et 11. Et c’est donc le numéro 10 qui accompagne le numéro 9 dans l’axe, comme Pelé à la Coupe du monde 58.
Malgré la bonne idée, celle-ci ne sera pas reconduite avant la finale de la FA Cup en 1933 entre Manchester City et Everton. Contrairement à la première expérience, cette fois-ci, les deux équipes se sont partagées les 22 premiers numéros : de 1 à 11 pour Everton et de 12 à 22 pour City. La numérotation derrière les maillots ne sera complètement adoptée en Angleterre qu’en 1939, revenant aux principes de base, c’est-à-dire des numéros liés au poste. La numérotation sera laissée de côté dans le contexte de Seconde Guerre mondiale, avant de revenir sur le devant de la scène lors de la Coupe du Monde 1954, sous un nouveau jour.
Une petite révolution à partir de 1954!
La FIFA a enfin tranché. À partir de cette année, il était enfin possible de choisir un numéro autre que les 11 premiers, permettant ainsi aux joueurs de personnaliser un peu plus leur profil. Mais si l’initiative semblait plus libre, elle était tout de même soumise à quelques petites règles en France, légèrement plus strictes :
« Chaque club de Ligue 1 et Ligue 2 doit établir la liste d’affectation des numéros. Cette liste ne peut excéder 30 noms, le numéro 30 est donc le dernier de la liste. Les numéros 1, 16 et 30 sont exclusivement et obligatoirement réservés aux gardiens de but. En dernier ressort, le numéro 40 peut être attribué. Toutes les équipes doivent disposer d’un maillot numéroté 33, non attribué à un joueur et réservé aux remplacements de dernière heure. »
Le championnat français n’autorise donc pas vraiment de fantaisies, mais ce n’est pas le cas de tous les autres championnats d’Europe. C’est notamment en Serie A (Italie) que les numéros les plus loufoques sont apparus. L’un des premiers exemples est celui d’Ivan Zamorano. Le Chilien aurait voulu obtenir le numéro 9 en arrivant à l’Inter Milan, mais celui-ci était déjà pris par un certain Ronaldo. Résultat : le joueur a pris le numéro 18, en ajoutant un « + » entre les deux pour obtenir le numéro 9. Ingénieux.
![]()
Ivan Zamorano et son fameux « 1+8 »
L’idée a aussi inspiré un certain Mario Balotelli, lui aussi quémandeur du fameux numéro 9, qui a pris le 45 dans son dos, espérant que les fans additionneraient les deux chiffres. Certains joueurs ont aussi fait leur choix de numéro en l’associant à quelque chose qui compte pour eux. C’était le cas de Bixente Lizarazu, lorsqu’il est arrivé au Bayern Munich. Le Français a décidé de prendre le numéro 69, en référence à son année de naissance, mais aussi à sa taille. Un double-sens plutôt drôle.
Ronaldinho avait lui aussi eu l’idée de prendre son année de naissance pour porter le numéro 80 derrière son maillot en arrivant à l’AC Milan, laissant ainsi le numéro 10 à Kaká, qui venait de remporter le Ballon d’Or. Dans le même club, une autre légende du nom de Ronaldo, le Brésilien, avait choisi le 99, au lieu du 9, qui était déjà occupé par Pipo Inzaghi.
![]()
R9 était devenu en arrivant à l’AC Milan, R99
L’emblématique numéro 10
Certains numéros sont parfois plus difficiles à porter que d’autres de par leur symbole historique. Le numéro 10 est un numéro à part. À l’origine, il était accordé au joueur qui prenait la place du milieu offensif, chargé de distribuer, orienter les attaques, et même frapper. Un joueur complet, physique, intelligent, si possible charismatique, donc le plus souvent, la star de l’équipe. De très nombreux grands joueurs l’ont porté à travers leur carrière, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont porté l’importance du numéro 10 à un niveau très élevé. Le jeune prodige Pelé est rapidement devenu un phénomène mondial grâce à la Coupe du monde 1958. C’est clairement grâce à Pelé que le numéro 10 est devenu un numéro emblématique du football.
De Pelé, à Zidane, en passant par Platini, Maradona, Riquelme, Ronaldinho ou encore Messi, porter le 10 dans le dos revient à jouer avec une pression supplémentaire sur les épaules. Même si les systèmes de jeu actuels ont quelque peu remplacé le rôle du numéro 10, il n’est pas rare de constater que celui qui le porte dans une équipe, est au-dessus du lot dans la hiérarchie du groupe.

Zinedine Zidane en Équipe de France, portant l’un des numéros les plus emblématique de l’histoire
Les numéro 9 et 7
Alors que les attaquants sont beaucoup plus mis en avant dans le football de manière générale, le 9 est lui aussi très apprécié et prisé des chasseurs de but. Le numéro 9 laisse entendre du joueur qu’il n’est là que pour terminer les actions, pour renflouer son compteur de buts, pour tout simplement permettre à son équipe de gagner.
Là aussi il faut avoir les épaules solides pour porter le 9, d’autant plus qu’un attaquant qui marque sera encensé au maximum, mais pourra aussi s’attirer les foudres des supporters s’il ne plante pas. Comme grands joueurs ayant porté ce numéro, les fans sont gâtés : Eto’o, Di Stefano, Papin, Benzema, Lewandowski, Shearer, Ronaldo etc.
Si vous êtes un grand fan CR7, vous savez peut-être, pourquoi Cristiano Ronaldo est autant attaché au numéro 7 ! Un certain George Best était l’une des stars du des années 60. Il a été Ballon d’or en 1968. George Best était un fou, il était un ailier droit et a porté donc le numéro 7, qui est devenu une réelle marque. C’est grâce à George Best que le numéro 7 est devenu si emblématique pour Manchester United. Par la suite, des joueurs comme Eric Cantona et David Beckham ont également affiché le numéro 7 dans leur dos. Cristiano Ronaldo a fini par récupérer le numéro 7 à United quand il a explosé au grand jour.
Considéré comme une idole par beaucoup, le Portugais a lancé un élan autour du 7, déjà considéré comme un numéro fétiche par beaucoup. Kylian Mbappé a même changé son 29 en 7 au PSG, étant un énorme fan de CR7.
:focal(983x577:985x575)/origin-imgresizer.eurosport.com/2021/09/02/3211641-65788088-2560-1440.jpg)
Crédit: Getty Images
Des numéros ont été retirés
Dans certains clubs, il n’est maintenant plus possible de porter certains numéros dans son dos, car ceux-ci, comme en NBA, ont été retirés. C’est par exemple le cas du 28 de Valbuena à l’Olympique de Marseille, club dans lequel il a forgé une grande histoire d’amour, même si son numéro a été réattribué après son arrivée à l’Olympique Lyonnais. Naples a fait de même, mais pour le numéro 10, après le passage de Maradona, qui a énormément fait pour le club italien. Même rengaine pour le numéro 3 de Maldini et le 6 de Baresi à l’AC Milan, deux défenseurs qui ont grandement participé à la légende de leur club.
D’autres clubs ont décidé de retirer des numéros afin de rendre hommage à des joueurs décédés. L’exemple le plus récent est celui de Davide Astori, le numéro 13 de la Fiorentina, décédé il y a quelques années d’un arrêt cardiaque. On a pu voir le même exemple après le décès de Marc-Vivien Foé, dont le 27 avait été retiré à Manchester City, et le 17 à l’Olympique Lyonnais et Lens.
S’il semble anodin de voir le numéro derrière le maillot d’un joueur, il est important de constater qu’il n’a rien d’anodin. Véritable puissance marketing, le numéro a parfois un sens insoupçonné qui représente énormément pour le joueur qui le porte. Porter le numéro 10 n’a pas le même poids que d’avoir le 17, et c’est une réalité qui construit parfois une hiérarchie au sein d’un club, comme aux yeux des supporters. Choisir son numéro ne relève plus du hasard aujourd’hui, puisqu’il détermine très souvent un message que l’on veut faire passer, et qu’il faut parfois assumer.
Pour ne rien rater de nos actualités, vous pouvez également visiter la page Facebook WeLoSport.